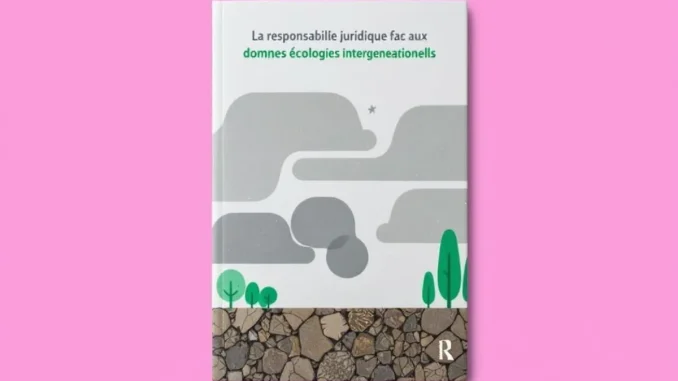
Face à l’amplification des crises environnementales, la question de la responsabilité pour dommages écologiques intergénérationnels s’impose dans le débat juridique contemporain. Cette problématique soulève des interrogations fondamentales sur notre capacité à protéger les droits des générations futures. Le cadre juridique actuel, principalement conçu pour traiter des préjudices immédiats et certains, se trouve confronté à l’enjeu de dommages différés, cumulatifs et parfois irréversibles. Entre innovations jurisprudentielles, évolutions législatives et réflexions doctrinales, le droit tente d’appréhender cette temporalité étendue qui caractérise la responsabilité environnementale. Cette analyse propose d’explorer les mécanismes juridiques émergents et de questionner leur efficacité face à ce défi majeur du XXIe siècle.
Fondements théoriques et philosophiques de la responsabilité intergénérationnelle
La notion de responsabilité intergénérationnelle trouve ses racines dans des réflexions philosophiques anciennes sur notre devoir moral envers ceux qui nous succéderont. Dans la tradition philosophique occidentale, le concept d’équité intergénérationnelle a été développé notamment par John Rawls dans sa « Théorie de la justice » (1971), où il évoque un « voile d’ignorance » qui devrait nous conduire à considérer les intérêts des générations futures comme les nôtres. Cette approche contractualiste a été complétée par les travaux de Hans Jonas qui, dans « Le Principe responsabilité » (1979), formule l’impératif catégorique suivant : « Agis de façon que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d’une vie authentiquement humaine sur terre ».
Sur le plan juridique, ces considérations éthiques se sont progressivement transformées en principes directeurs. Le principe de développement durable, consacré lors du Sommet de Rio en 1992, constitue une première reconnaissance internationale de cette responsabilité temporellement étendue. Il définit le développement durable comme « un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs ». Cette formulation marque l’entrée des préoccupations intergénérationnelles dans le champ normatif international.
La traduction juridique de ces préoccupations s’est manifestée à travers plusieurs innovations conceptuelles. La notion de patrimoine commun de l’humanité, appliquée initialement aux grands fonds marins puis étendue à d’autres domaines, intègre une dimension temporelle qui transcende les générations. De même, le principe de précaution, formalisé dans la Déclaration de Rio puis intégré dans de nombreux ordres juridiques nationaux, constitue un outil préventif permettant d’agir face à l’incertitude scientifique pour éviter des dommages graves et irréversibles.
L’émergence des droits des générations futures
Progressivement, la doctrine juridique a conceptualisé de véritables droits des générations futures. Cette construction théorique pose néanmoins d’importantes questions juridiques : comment reconnaître des droits à des personnes qui n’existent pas encore ? Qui peut légitimement représenter leurs intérêts ? Edith Brown Weiss, dans ses travaux précurseurs, a proposé le concept d' »équité intergénérationnelle » comme fondement d’obligations actuelles envers les générations futures. Selon cette approche, chaque génération reçoit la planète en héritage fiduciaire et doit la transmettre dans un état non dégradé.
Certains systèmes juridiques ont commencé à institutionnaliser cette préoccupation. La Constitution polonaise de 1997 mentionne explicitement la responsabilité « envers les générations futures ». En Hongrie, un « Ombudsman pour les générations futures » a été créé pour défendre leurs intérêts dans les processus décisionnels actuels. Plus récemment, la Cour constitutionnelle allemande, dans sa décision historique du 24 mars 2021 concernant la loi sur la protection du climat, a reconnu que les dispositions constitutionnelles sur la protection de l’environnement comportent une dimension intergénérationnelle contraignante.
- Reconnaissance progressive des droits des générations futures dans les constitutions nationales
- Création d’institutions spécifiques dédiées à la représentation des intérêts futurs
- Développement jurisprudentiel du concept d’équité intergénérationnelle
Cette évolution conceptuelle constitue le socle théorique sur lequel peuvent se construire des mécanismes juridiques opérationnels de responsabilité pour dommages écologiques intergénérationnels. Elle pose toutefois la question fondamentale de l’articulation entre le temps du droit, traditionnellement ancré dans l’immédiateté, et le temps long de l’écologie qui s’étend sur plusieurs générations.
Obstacles juridiques à la reconnaissance des préjudices écologiques intergénérationnels
La mise en œuvre effective d’une responsabilité pour dommages écologiques intergénérationnels se heurte à plusieurs obstacles juridiques majeurs. Le premier relève de la temporalité inhérente au droit de la responsabilité. Traditionnellement, ce dernier exige un préjudice actuel et certain pour être caractérisé. Or, les dommages écologiques intergénérationnels présentent par nature un caractère futur et souvent incertain dans leur ampleur exacte. Cette distorsion temporelle constitue un défi pour les systèmes juridiques contemporains.
Le lien de causalité, élément constitutif classique de la responsabilité civile, pose également des difficultés considérables. Les dommages environnementaux résultent fréquemment de causes multiples, diffuses et cumulatives, s’étendant sur de longues périodes. Dans l’affaire Urgenda aux Pays-Bas (2019), la Cour suprême a dû reconnaître une causalité partielle pour permettre d’engager la responsabilité de l’État dans la lutte contre le changement climatique. Cette approche novatrice reste cependant exceptionnelle dans le paysage juridique mondial.
Un autre obstacle majeur concerne la prescription des actions en responsabilité. Dans la plupart des systèmes juridiques, les délais de prescription commencent à courir à partir de la manifestation du dommage ou de sa connaissance par la victime. Cette conception s’avère inadaptée aux dommages écologiques qui peuvent n’apparaître que plusieurs décennies après les faits générateurs. La directive européenne 2004/35/CE sur la responsabilité environnementale a tenté de répondre à cette problématique en prévoyant un délai de prescription de trente ans à compter du fait générateur pour certains dommages environnementaux, mais cette durée reste insuffisante face à des préjudices susceptibles d’affecter plusieurs générations.
La question de l’intérêt à agir
L’intérêt à agir constitue un obstacle procédural majeur. Les règles classiques exigent un intérêt personnel, direct et actuel pour introduire une action en justice. Comment, dès lors, permettre la défense des intérêts des générations futures ? Certains systèmes juridiques ont commencé à apporter des réponses innovantes. En France, la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité a consacré l’action en réparation du préjudice écologique pur, permettant à certaines personnes morales (collectivités territoriales, associations agréées) d’agir sans avoir à démontrer un préjudice personnel. Cette avancée reste néanmoins limitée par la nécessité d’un dommage actuel.
Le droit international se heurte quant à lui à des difficultés supplémentaires liées à la souveraineté des États et à l’absence de mécanisme contraignant de règlement des différends environnementaux de portée universelle. La Cour internationale de Justice a certes reconnu dans l’affaire Gabčíkovo-Nagymaros (1997) que « l’environnement n’est pas une abstraction mais bien l’espace où vivent les êtres humains et dont dépendent la qualité de leur vie et leur santé, y compris pour les générations à venir », mais cette reconnaissance reste largement déclaratoire.
- Inadéquation des critères classiques de préjudice actuel et certain
- Complexité de l’établissement du lien de causalité pour des dommages diffus et différés
- Insuffisance des délais de prescription face à des dommages transgénérationnels
- Limitations de l’intérêt à agir traditionnel pour défendre les générations futures
Ces obstacles structurels expliquent en grande partie pourquoi, malgré une prise de conscience croissante, les mécanismes juridiques de responsabilité peinent à appréhender efficacement la dimension intergénérationnelle des dommages écologiques. Ils appellent à une refonte profonde des concepts traditionnels du droit de la responsabilité pour les adapter aux enjeux environnementaux contemporains.
Innovations jurisprudentielles et contentieux climatiques
Face aux limites des cadres juridiques traditionnels, les tribunaux du monde entier ont commencé à développer des approches innovantes pour traiter les questions de responsabilité environnementale intergénérationnelle. Le contentieux climatique constitue un laboratoire particulièrement fécond de ces évolutions jurisprudentielles. L’affaire Juliana v. United States, initiée en 2015 par vingt-et-un jeunes Américains, illustre cette tendance. Les requérants y invoquent la violation de leurs droits constitutionnels et la doctrine de la public trust doctrine (obligation fiduciaire publique) pour contraindre le gouvernement fédéral à adopter une politique climatique ambitieuse. Bien que cette affaire ait connu des revers procéduraux, elle a contribué à façonner le débat juridique sur les obligations intergénérationnelles.
En Europe, l’affaire Urgenda aux Pays-Bas a marqué un tournant décisif. En 2019, la Cour suprême néerlandaise a confirmé que l’État avait l’obligation de réduire ses émissions de gaz à effet de serre d’au moins 25% d’ici fin 2020 par rapport aux niveaux de 1990, en se fondant notamment sur les articles 2 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (droit à la vie et droit au respect de la vie privée et familiale). Cette décision historique a inspiré des contentieux similaires dans d’autres juridictions européennes.
En France, l’affaire Grande-Synthe a conduit le Conseil d’État à reconnaître, dans sa décision du 19 novembre 2020, l’obligation pour l’État de respecter ses engagements en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Dans le même esprit, l’Affaire du Siècle a abouti en 2021 à la reconnaissance d’une faute de l’État français pour manquement à ses obligations climatiques, avec une injonction à prendre des mesures supplémentaires pour atteindre ses objectifs de réduction d’émissions.
L’approche constitutionnelle du contentieux climatique
Particulièrement novatrice est la décision rendue le 24 mars 2021 par la Cour constitutionnelle allemande concernant la loi fédérale sur la protection du climat. La Cour y a jugé que les dispositions de cette loi étaient partiellement inconstitutionnelles car elles reportaient de manière disproportionnée les efforts de réduction des émissions après 2030, faisant ainsi peser une charge excessive sur les générations futures. Cette décision reconnaît explicitement une obligation constitutionnelle de protection intergénérationnelle du climat.
Dans les pays du Sud global, des approches juridiques innovantes se développent également. En Colombie, la Cour suprême a rendu en 2018 une décision remarquable dans l’affaire Future Generations v. Ministry of the Environment, reconnaissant l’Amazonie colombienne comme sujet de droits et ordonnant au gouvernement d’élaborer un plan d’action pour lutter contre la déforestation. Cette décision s’appuie sur une conception des droits qui intègre explicitement les intérêts des générations futures.
- Recours croissant aux droits fondamentaux pour fonder une responsabilité climatique
- Reconnaissance judiciaire d’obligations étatiques envers les générations futures
- Développement de l’approche constitutionnelle du contentieux climatique
- Émergence de décisions reconnaissant les droits de la nature comme vecteur de protection intergénérationnelle
Ces innovations jurisprudentielles, bien qu’encore disparates et parfois limitées dans leur portée, dessinent progressivement les contours d’un régime de responsabilité adapté aux enjeux intergénérationnels. Elles témoignent de la capacité du droit à évoluer face aux défis environnementaux contemporains, malgré les obstacles conceptuels et procéduraux identifiés précédemment.
Mécanismes juridiques préventifs et précaution renforcée
Face aux limites inhérentes aux mécanismes de responsabilité réparatrice pour les dommages intergénérationnels, le droit contemporain s’oriente vers des approches préventives renforcées. Le principe de précaution, consacré dans de nombreux instruments juridiques nationaux et internationaux, constitue un pilier de cette stratégie. En France, son inscription dans la Charte de l’environnement de 2004, à valeur constitutionnelle, lui confère une portée juridique considérable. L’article 5 de cette Charte dispose que « lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution, à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées ».
L’étude d’impact environnemental constitue un autre outil préventif majeur. Initialement développée aux États-Unis avec le National Environmental Policy Act de 1969, cette procédure s’est généralisée à l’échelle mondiale. La directive européenne 2011/92/UE modifiée par la directive 2014/52/UE impose une évaluation préalable des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. Cette évaluation doit désormais intégrer explicitement les effets à long terme des projets, incluant potentiellement leurs impacts sur les générations futures.
Les mécanismes d’autorisation préalable et le développement de normes techniques contraignantes jouent également un rôle préventif significatif. Le règlement européen REACH sur les substances chimiques illustre cette approche en imposant aux industriels de prouver l’innocuité des substances avant leur mise sur le marché, renversant ainsi la charge de la preuve traditionnelle. Ce système d’autorisation préalable, fondé sur le principe « pas de données, pas de marché », vise à prévenir les dommages sanitaires et environnementaux à long terme.
L’institutionnalisation de la protection des intérêts futurs
Au-delà des mécanismes juridiques traditionnels, on observe une tendance à l’institutionnalisation de la protection des intérêts des générations futures. En Hongrie, l’Ombudsman pour les générations futures, créé en 2007, dispose de pouvoirs d’investigation et de recommandation sur les politiques susceptibles d’affecter l’environnement à long terme. Au Pays de Galles, le Well-being of Future Generations Act de 2015 a instauré un Commissaire aux générations futures chargé de veiller à ce que les décisions publiques prennent en compte leurs intérêts.
La constitutionnalisation des préoccupations environnementales intergénérationnelles représente une évolution significative. La Constitution équatorienne de 2008 reconnaît explicitement les droits de la Pacha Mama (Terre Mère) et établit un régime juridique du « buen vivir » qui intègre une dimension temporelle étendue. De même, la Constitution bolivienne de 2009 fait référence aux générations futures dans ses dispositions relatives à l’environnement.
- Développement d’institutions spécifiquement dédiées à la représentation des intérêts futurs
- Renforcement des procédures d’évaluation préalable des impacts à long terme
- Inversion de la charge de la preuve pour les activités potentiellement dommageables
- Constitutionnalisation croissante des préoccupations environnementales intergénérationnelles
Ces mécanismes préventifs, en complément des régimes de responsabilité, dessinent progressivement un cadre juridique plus adapté aux enjeux intergénérationnels. Ils témoignent d’une prise de conscience de la nécessité d’agir en amont des dommages, particulièrement lorsque ceux-ci risquent d’être irréversibles ou de s’étendre sur plusieurs générations. Leur efficacité reste toutefois conditionnée par la volonté politique de leur mise en œuvre effective et par l’allocation de ressources suffisantes aux institutions chargées de leur application.
Vers un nouveau paradigme juridique pour l’équité intergénérationnelle
L’inadéquation partielle des mécanismes juridiques traditionnels face aux dommages écologiques intergénérationnels invite à repenser en profondeur les fondements mêmes de notre ordre juridique. Cette refonte conceptuelle pourrait s’articuler autour de plusieurs axes novateurs. Le premier concerne la temporalité du droit. Notre système juridique, largement construit sur une conception linéaire et relativement courte du temps, doit intégrer des échelles temporelles beaucoup plus étendues. La proposition de Jérémie Bentham d’un « taux d’actualisation moral nul » dans l’évaluation des intérêts futurs mérite d’être réexaminée : elle suggère que les intérêts des personnes futures devraient être valorisés au même niveau que ceux des personnes présentes.
Le deuxième axe concerne la subjectivité juridique. La reconnaissance progressive de nouveaux sujets de droit – comme les éléments naturels dans certains systèmes juridiques – ouvre des perspectives intéressantes. En Nouvelle-Zélande, le fleuve Whanganui s’est vu reconnaître une personnalité juridique en 2017, avec des gardiens désignés pour représenter ses intérêts. Cette approche, inspirée par les conceptions Māori de la relation entre humains et nature, pourrait constituer un modèle pour protéger les intérêts environnementaux sur le long terme, au-delà des générations humaines actuelles.
Le troisième axe implique une redéfinition de la notion de patrimoine. Le concept de patrimoine commun de l’humanité, déjà présent en droit international, pourrait être approfondi et doté de mécanismes juridiques plus contraignants. La théorie des communs, développée notamment par Elinor Ostrom, offre des pistes pour concevoir des modes de gouvernance adaptés à la gestion durable de ressources partagées entre générations. Ces approches impliquent de dépasser la dichotomie traditionnelle entre propriété publique et propriété privée pour développer des régimes juridiques hybrides.
Repenser la responsabilité juridique dans une perspective intergénérationnelle
La responsabilité juridique elle-même doit être reconceptualisée. Le modèle classique, fondé sur la réparation d’un préjudice causé par un fait générateur identifiable, pourrait évoluer vers une conception plus collective et préventive. La notion de responsabilité fiduciaire envers les générations futures, développée dans les travaux d’Edith Brown Weiss, offre un cadre théorique prometteur. Elle implique une obligation de préserver l’intégrité des systèmes écologiques et l’accès équitable aux ressources naturelles pour les générations futures.
Des innovations procédurales sont également nécessaires. La création d’actions collectives spécifiques pour la protection des intérêts futurs, l’assouplissement des conditions de recevabilité des recours, ou encore la mise en place de fonds d’indemnisation à long terme pour les dommages écologiques constituent autant de pistes à explorer. Le Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (FIPOL) pourrait servir de modèle, bien qu’il faille l’adapter aux spécificités des dommages intergénérationnels.
- Intégration d’échelles temporelles étendues dans les raisonnements juridiques
- Reconnaissance de nouveaux sujets de droit pour protéger les intérêts environnementaux à long terme
- Développement de régimes juridiques hybrides pour les « communs intergénérationnels »
- Reconceptualisation de la responsabilité juridique dans une perspective fiduciaire
Ces transformations conceptuelles ne seront pleinement effectives que si elles s’accompagnent d’une évolution de notre rapport culturel au temps et à la nature. Le droit ne peut, à lui seul, résoudre la crise écologique intergénérationnelle, mais il peut contribuer à poser les jalons d’un nouveau contrat social étendu aux générations futures. Cette ambition suppose un dialogue interdisciplinaire entre juristes, philosophes, économistes, scientifiques et citoyens pour construire collectivement ce nouveau paradigme juridique.
Perspectives d’avenir et responsabilité transformatrice
L’évolution du droit de la responsabilité face aux dommages écologiques intergénérationnels s’inscrit dans une dynamique plus large de transformation de nos systèmes juridiques. Pour être véritablement efficace, cette évolution devra intégrer plusieurs dimensions complémentaires. La première concerne l’articulation entre échelons locaux et globaux. Les dommages environnementaux transcendent souvent les frontières nationales, tant dans l’espace que dans le temps. Le développement d’un véritable droit global de l’environnement, dépassant les limites du droit international classique fondé sur le consentement des États, apparaît comme une nécessité. Le projet de Pacte mondial pour l’environnement, bien qu’actuellement en suspens, illustre cette aspiration à un cadre juridique universel intégrant explicitement la dimension intergénérationnelle.
La deuxième dimension concerne l’interaction entre droit et technologies. Les avancées dans les domaines de la modélisation climatique, du suivi satellitaire ou de l’intelligence artificielle offrent des outils nouveaux pour anticiper, mesurer et prévenir les dommages environnementaux à long terme. Le droit doit s’approprier ces outils tout en encadrant leur utilisation. La création de registres numériques sécurisés permettant de tracer les responsabilités environnementales sur de longues périodes constitue une piste prometteuse, de même que le développement de systèmes d’alerte précoce juridiquement contraignants.
La troisième dimension relève de l’éducation juridique et de la formation des acteurs du droit. La prise en compte effective des enjeux intergénérationnels suppose une évolution des mentalités et des pratiques professionnelles. L’intégration systématique des questions environnementales dans la formation des juristes, le développement de la clinique juridique environnementale, ou encore la sensibilisation des magistrats aux enjeux écologiques de long terme sont autant de leviers pour accélérer cette transformation culturelle du monde juridique.
Vers une responsabilité proactive et transformatrice
Au-delà de ces aspects techniques, c’est peut-être vers une conception plus proactive et transformatrice de la responsabilité qu’il faut s’orienter. Plutôt que de se limiter à réparer des dommages déjà survenus ou à prévenir des risques identifiés, le droit pourrait contribuer à promouvoir activement une transition vers des sociétés plus respectueuses des équilibres écologiques et des intérêts des générations futures. Cette approche rejoint le concept de justice transformatrice développé notamment dans les travaux sur la justice climatique.
Des expérimentations juridiques novatrices émergent en ce sens. En Nouvelle-Zélande, le Te Awa Tupua Act de 2017 ne se contente pas de reconnaître la personnalité juridique du fleuve Whanganui, mais établit un cadre de gouvernance participative associant autorités publiques et communautés Māori dans une logique de responsabilité partagée. En France, la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique a institué un délit de mise en danger de l’environnement, permettant de sanctionner des comportements avant même la survenance d’un dommage, dans une logique préventive renforcée.
- Développement nécessaire d’un droit global de l’environnement intégrant la dimension intergénérationnelle
- Utilisation des nouvelles technologies pour anticiper et prévenir les dommages futurs
- Transformation des pratiques juridiques et de la formation des acteurs du droit
- Émergence d’une conception proactive et transformatrice de la responsabilité environnementale
Ces perspectives d’avenir dessinent les contours d’un droit de la responsabilité profondément renouvelé, capable de répondre aux défis écologiques intergénérationnels. Ce renouvellement suppose non seulement des innovations techniques et conceptuelles, mais aussi une réflexion éthique approfondie sur notre rapport au temps, à la nature et aux générations qui nous succéderont. Le droit peut ainsi contribuer à l’émergence d’un nouveau contrat naturel, pour reprendre l’expression du philosophe Michel Serres, qui intégrerait pleinement la dimension temporelle étendue de notre responsabilité collective.
FAQ sur la responsabilité pour dommages écologiques intergénérationnels
Quels sont les principaux obstacles juridiques à la reconnaissance des dommages écologiques intergénérationnels?
Les principaux obstacles juridiques incluent la difficulté à établir un préjudice certain et actuel pour des dommages futurs, la complexité de prouver un lien de causalité pour des phénomènes écologiques multifactoriels et différés, les délais de prescription inadaptés aux dommages s’étendant sur plusieurs générations, et les limitations de l’intérêt à agir traditionnel qui exige un préjudice personnel et direct. Ces obstacles structurels sont ancrés dans une conception du droit de la responsabilité historiquement focalisée sur les relations interindividuelles à court terme, ce qui ne correspond pas à la nature des dommages écologiques intergénérationnels.
Comment définir juridiquement les générations futures?
La définition juridique des générations futures reste un défi conceptuel majeur. Plusieurs approches coexistent. Une approche restrictive les définit comme les personnes qui naîtront dans un futur prévisible (enfants et petits-enfants des personnes actuellement vivantes). Une approche plus extensive englobe l’ensemble des personnes qui vivront après nous, sans limitation temporelle. Certains systèmes juridiques, comme la Constitution polonaise, font référence aux générations futures sans les définir précisément, laissant aux juges et aux législateurs le soin d’en préciser les contours. Cette indétermination constitue à la fois un défi et une souplesse nécessaire face à l’incertitude inhérente aux questions intergénérationnelles.
Quelles innovations jurisprudentielles récentes ont fait avancer la reconnaissance des responsabilités intergénérationnelles?
Plusieurs décisions marquantes ont contribué à cette avancée. La décision de la Cour constitutionnelle allemande du 24 mars 2021 a reconnu que la protection du climat comportait une dimension constitutionnelle intergénérationnelle. L’arrêt Urgenda de la Cour suprême néerlandaise (2019) a établi une obligation étatique de protection climatique fondée sur les droits humains. En Colombie, la décision Future Generations v. Ministry of the Environment (2018) a reconnu les droits des générations futures en lien avec la protection de l’Amazonie. Ces décisions, bien que diverses dans leurs fondements juridiques, convergent vers une reconnaissance accrue des obligations actuelles envers les générations futures.
Comment concilier souveraineté étatique et protection des intérêts environnementaux intergénérationnels?
La tension entre souveraineté nationale et protection des intérêts environnementaux globaux et intergénérationnels constitue un enjeu majeur du droit international contemporain. Plusieurs approches émergent pour tenter de la résoudre. Le développement du concept d’obligations erga omnes en matière environnementale permettrait de reconnaître des obligations envers la communauté internationale dans son ensemble, y compris les générations futures. L’évolution du principe de souveraineté permanente sur les ressources naturelles vers une conception plus responsable, intégrant des devoirs de préservation, constitue une autre piste. Enfin, le renforcement des mécanismes de gouvernance mondiale de l’environnement, avec des institutions dotées de pouvoirs contraignants, pourrait contribuer à dépasser les limites de la souveraineté classique face aux enjeux écologiques globaux.
Quels mécanismes financiers pourraient soutenir la réparation des dommages écologiques intergénérationnels?
Face à la temporalité étendue des dommages écologiques, des mécanismes financiers innovants sont nécessaires. La création de fonds fiduciaires environnementaux de long terme, dotés de garanties d’indépendance et de pérennité, constitue une option prometteuse. Ces fonds pourraient être alimentés par des contributions obligatoires des acteurs économiques dans les secteurs à risque environnemental élevé. Le développement de mécanismes assurantiels adaptés aux risques écologiques de long terme représente une autre piste, bien que la difficulté à quantifier ces risques pose des défis techniques considérables. Enfin, l’intégration du capital naturel dans les comptabilités publiques et privées permettrait de mieux valoriser et préserver les actifs environnementaux dans une perspective intergénérationnelle.
