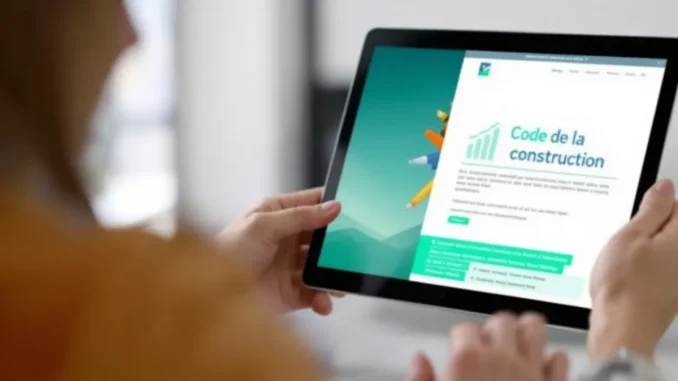
Dans un contexte d’urgence climatique et de transition énergétique, les réglementations du bâtiment connaissent des évolutions majeures. Ces changements, souvent techniques et complexes, impactent directement les professionnels du secteur mais aussi les particuliers qui entreprennent des travaux. Décryptage des dernières modifications du code de la construction et de l’habitation qui redessinent le paysage immobilier français.
Les fondements de la réforme du code de la construction
La réforme du code de la construction s’inscrit dans une volonté de modernisation profonde du cadre réglementaire français. Initiée par la loi ELAN (Évolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique) de 2018, cette refonte vise à simplifier et à clarifier les règles tout en les adaptant aux enjeux contemporains. L’objectif affiché est double : favoriser l’innovation dans le secteur du bâtiment et accélérer la transition écologique.
Cette réforme marque un changement paradigmatique, passant d’une logique de moyens à une logique de résultats. Désormais, les constructeurs disposent d’une plus grande liberté dans le choix des solutions techniques, à condition que celles-ci permettent d’atteindre les objectifs de performance fixés par la réglementation. Cette approche, saluée par les professionnels, ouvre la voie à l’expérimentation et à l’émergence de solutions constructives innovantes.
La RE2020 : pilier central des nouvelles exigences
Au cœur de cette évolution réglementaire se trouve la Réglementation Environnementale 2020 (RE2020), qui remplace la RT2012. Cette nouvelle réglementation, entrée progressivement en vigueur depuis le 1er janvier 2022, constitue une avancée majeure dans la prise en compte des enjeux environnementaux dans le secteur de la construction.
La RE2020 se distingue par trois objectifs principaux : diminuer l’impact carbone des bâtiments, poursuivre l’amélioration de leur performance énergétique et garantir le confort des occupants en période de forte chaleur. Pour y parvenir, elle introduit des indicateurs innovants comme l’analyse du cycle de vie (ACV) des matériaux et équipements utilisés.
Cette réglementation impose des seuils d’émissions de gaz à effet de serre pour la construction et l’exploitation des bâtiments, favorisant ainsi les matériaux biosourcés et les énergies renouvelables. Elle renforce également les exigences en matière d’isolation thermique et de systèmes énergétiques, avec pour horizon la neutralité carbone du secteur d’ici 2050.
Accessibilité et sécurité : des normes renforcées
Les mises à jour du code de la construction accordent une place importante à l’accessibilité des bâtiments aux personnes à mobilité réduite. Les nouvelles dispositions prévoient que 20% des logements neufs en rez-de-chaussée ou desservis par ascenseur doivent être accessibles, tandis que les 80% restants doivent être « évolutifs », c’est-à-dire facilement adaptables aux besoins spécifiques.
En matière de sécurité incendie, les exigences ont également été revues à la hausse. Les bâtiments d’habitation collectifs neufs de plus de 28 mètres doivent désormais être équipés de systèmes de sécurité incendie renforcés. Par ailleurs, l’installation de détecteurs de fumée normalisés (DAAF) reste obligatoire dans tous les logements.
La protection contre les risques naturels fait aussi l’objet d’une attention particulière, avec des prescriptions spécifiques pour les constructions en zones inondables ou sismiques. Ces mesures s’inscrivent dans une démarche d’anticipation des conséquences du changement climatique sur le bâti. Si vous envisagez des travaux importants, n’hésitez pas à consulter des experts en construction et rénovation qui pourront vous guider dans ce dédale réglementaire.
Rénovation énergétique : un cadre juridique incitatif
La rénovation du parc immobilier existant constitue un enjeu majeur pour atteindre les objectifs climatiques de la France. Le code de la construction intègre désormais plusieurs dispositions visant à accélérer ce processus, notamment à travers le dispositif éco-énergie tertiaire qui impose une réduction progressive de la consommation d’énergie des bâtiments tertiaires.
Pour le secteur résidentiel, la loi Climat et Résilience de 2021 a introduit l’interdiction progressive de location des « passoires thermiques », ces logements énergivores classés F ou G au diagnostic de performance énergétique (DPE). Cette mesure, qui entrera en application par étapes entre 2023 et 2034, contraint les propriétaires à entreprendre des travaux de rénovation énergétique.
Pour accompagner ces transformations, plusieurs dispositifs d’aide financière ont été renforcés ou créés, comme MaPrimeRénov’, les certificats d’économie d’énergie (CEE) ou l’éco-prêt à taux zéro. Ces mécanismes, dont les modalités sont précisées dans le code de la construction, visent à lever les freins économiques à la rénovation énergétique.
Numérique et construction : vers le BIM obligatoire
La transformation numérique du secteur de la construction est également au cœur des évolutions réglementaires récentes. Le code de la construction encourage désormais l’utilisation du Building Information Modeling (BIM), un processus de conception collaborative basé sur des maquettes numériques 3D.
Pour les marchés publics de construction dont le montant est supérieur à certains seuils, l’utilisation du BIM devient progressivement obligatoire. Cette exigence vise à améliorer la qualité des constructions, à réduire les coûts et à faciliter la maintenance des bâtiments tout au long de leur cycle de vie.
Par ailleurs, le carnet numérique d’information, de suivi et d’entretien du logement (CNIEL) sera progressivement généralisé. Ce document dématérialisé regroupera toutes les informations utiles à la bonne utilisation, à l’entretien et à l’amélioration progressive de la performance énergétique du logement.
Impacts sur les professionnels et les particuliers
Ces évolutions réglementaires ont des répercussions importantes sur l’ensemble des acteurs du secteur. Pour les professionnels de la construction, elles impliquent une mise à jour des compétences et des pratiques, notamment en matière d’éco-conception et de numérique. Les bureaux d’études et les architectes doivent désormais intégrer les analyses de cycle de vie dès la phase de conception.
Pour les particuliers qui souhaitent faire construire ou rénover leur logement, ces changements se traduisent par des bâtiments plus performants et plus respectueux de l’environnement, mais aussi potentiellement plus coûteux à court terme. Cependant, les économies d’énergie réalisées sur le long terme et la valorisation du patrimoine immobilier compensent généralement ce surcoût initial.
Les collectivités territoriales sont également concernées, notamment à travers l’élaboration des documents d’urbanisme qui doivent désormais prendre en compte ces nouvelles exigences. Elles jouent aussi un rôle clé dans l’accompagnement des particuliers et des professionnels dans cette transition.
Perspectives et évolutions futures
Le code de la construction continuera d’évoluer dans les années à venir pour s’adapter aux enjeux environnementaux, sociaux et économiques. Plusieurs tendances se dessinent déjà, comme le renforcement des exigences en matière de biodiversité et de gestion de l’eau dans les projets de construction.
La question de l’économie circulaire dans le bâtiment prend également de l’importance, avec des dispositions favorisant le réemploi des matériaux et la réduction des déchets de chantier. Le diagnostic ressources, qui identifie les matériaux pouvant être réutilisés lors d’une démolition, deviendra progressivement obligatoire pour certains types de bâtiments.
Enfin, l’adaptation au changement climatique constituera un axe majeur des futures évolutions réglementaires, avec des mesures visant à renforcer la résilience des bâtiments face aux aléas climatiques (canicules, inondations, tempêtes) de plus en plus fréquents et intenses.
Les mises à jour du code de la construction témoignent d’une prise de conscience collective des enjeux environnementaux et sociaux liés au secteur du bâtiment. Si elles imposent de nouvelles contraintes aux acteurs, elles ouvrent également des opportunités d’innovation et de création de valeur. Dans ce contexte en mutation rapide, une veille réglementaire attentive et une anticipation des évolutions futures deviennent essentielles pour tous les acteurs du secteur.
